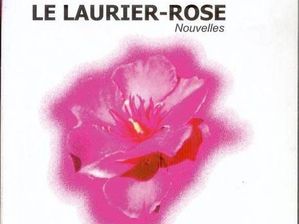 L’auteur du recueil de nouvelles Laurier rose, édité par la maison de la culture de Médéa et tiré à l’imprimerie Mauguin (Blida), nous raconte des bouts de vie comme il le ferait avec un ami, sans se gêner, ni faire dans le protocole. Ses mots, où l’aisance dans la formulation le dispute à l’insolence, partent dès le départ en réseaux de partage de connivence exercée, mais non dite. Il y a une correspondance intime entre les héros et le lecteur solitaire, où qu’il se trouve. Les histoires que raconte l’écrivain de Ksar El Boukhari, patrie du l’indémodable Boubagra et des deux frères repères du théâtre algérien, Mohamed et Abdelkader Ferrah, ne sont pas inventées, mais plutôt réinventées grâce à la puissance sereine de ce terroir qui nous parle, qui nous guide, qui nous inspire, mais qu’on ne sait pas toujours écouter, interroger dans ce qu’il a de plus généreux, sa disponibilité. Il y dans le travail de Mohamed Bourahla d’exquises métaphores langagières puisées de chez nous, mais aussi de redoutables et redoutées vérités sur nos us et coutumes dévoyées, nos comportements frelatés. Témoin de son temps, il sait appuyer sur l’instantané pour dire l’épaisseur de son temps.
L’auteur du recueil de nouvelles Laurier rose, édité par la maison de la culture de Médéa et tiré à l’imprimerie Mauguin (Blida), nous raconte des bouts de vie comme il le ferait avec un ami, sans se gêner, ni faire dans le protocole. Ses mots, où l’aisance dans la formulation le dispute à l’insolence, partent dès le départ en réseaux de partage de connivence exercée, mais non dite. Il y a une correspondance intime entre les héros et le lecteur solitaire, où qu’il se trouve. Les histoires que raconte l’écrivain de Ksar El Boukhari, patrie du l’indémodable Boubagra et des deux frères repères du théâtre algérien, Mohamed et Abdelkader Ferrah, ne sont pas inventées, mais plutôt réinventées grâce à la puissance sereine de ce terroir qui nous parle, qui nous guide, qui nous inspire, mais qu’on ne sait pas toujours écouter, interroger dans ce qu’il a de plus généreux, sa disponibilité. Il y dans le travail de Mohamed Bourahla d’exquises métaphores langagières puisées de chez nous, mais aussi de redoutables et redoutées vérités sur nos us et coutumes dévoyées, nos comportements frelatés. Témoin de son temps, il sait appuyer sur l’instantané pour dire l’épaisseur de son temps.
En termes vifs, assez régulièrement en termes tranchants, toujours en face à face. Néanmoins, il faut préciser que l’homme de lettres ne fait pas dans la morale. A la fois tendre et original, il ne se met jamais dans la posture du donneur de leçons qui sait tout, qui se situe au-dessus de la mêlée, qui n’est là que pour questionner la mêlée. Le coucheur de lignes inspiré qu’il constate se révolte ici et là, s’exprime de manière loufoque ou véhémente, fait des mises au point à «la langue-véhicule», mais s’interdit de s’adosser à la bonne conscience. Ses nouvelles, qui, pour certaines, peuvent être aisément gonflées en roman, sont plus dans l’émotion que dégage le vécu immédiat que dans la leçon. Traversées de bout en bout par le doute, elles sont plus dans le fervent désir de découvrir que dans le recroquevillement ou encore l’absolutisme.
A la fois lucides et détachées, les répliques sont pleines de résonances réalistes, un réalisme rendu savoureux grâce à l’utilisation judicieuse d’un style chargé de référents culturels qui savent nous parler, nous interpeller, nous secouer. Et ce qui nous surprend le plus, c’est que les dix nouvelles contenues dans Le Laurier rose ne sont pas copiées les unes sur les autres. Certes, elles baignent toutes dans le même environnement, puisent éventuellement des mêmes mémoires descriptifs, donnent l’air d’être indissociables par moments, mais elles sont presque toutes autonomes dans la manière de rendre l’évènement, pour le développer, le mener au point final, le déchiffrer éventuellement.
Le récit, rebelle à un corsage éventuel préétabli, est toujours renouvelé, chaleureux, pour ne pas dire complice dans son rapport avec le lecteur. La manière d’écrire est dynamique, inscrite volontairement comme une sorte de tendre balise pour se frayer son chemin, se situer, dire ce qu’on a à dire sans trop se prendre au sérieux, même si les problèmes exposés sont tout ce qu’il y a de plus sérieux. Le recueil est lisible, visible, son charme est prégnant dès le premier chapitre où l’écriture adoptée évite les grandiloquences verbales et les postulats rébarbatifs, et c’est cela l’essentiel pour nous qui avions eu la chance de lire simplement Le Laurier rose. Soulignons que Mohamed Bourahla écrit dans les deux langues, arabe et français, et qu’il est, par ailleurs, auteur de deux autres ouvrages de fiction, Al-Khobz Wal Idam et Le Pire des mots.






 Part
Part Même si on ne dit plus «ici c’est mieux que là-bas», on dit toujours qu’avant c’était mieux qu’aujourd’hui. En tout cas, Avant, c’était mieux est le titre du nouveau livre de Slim.
Même si on ne dit plus «ici c’est mieux que là-bas», on dit toujours qu’avant c’était mieux qu’aujourd’hui. En tout cas, Avant, c’était mieux est le titre du nouveau livre de Slim. Vivre dans une décharge, en dehors de la ville car celle-ci n’accepte pas n’importe qui, voilà le destin de Junior, Ach le Borgne, Bliss, Haroun le Sourd, le Pacha… personnages aux personnalités marquées, dominatrices ou soumises. Ils n’ont rien ou si peu, ils se soutiennent, se détestent parfois, se disputent mais la solidarité l’emporte toujours dans les moments les plus durs. Ils se doivent de garder un équilibre qui garantit la paix dans ce lieu où pour que la police les laisse tranquilles mieux vaut ne pas se faire remarquer.
Vivre dans une décharge, en dehors de la ville car celle-ci n’accepte pas n’importe qui, voilà le destin de Junior, Ach le Borgne, Bliss, Haroun le Sourd, le Pacha… personnages aux personnalités marquées, dominatrices ou soumises. Ils n’ont rien ou si peu, ils se soutiennent, se détestent parfois, se disputent mais la solidarité l’emporte toujours dans les moments les plus durs. Ils se doivent de garder un équilibre qui garantit la paix dans ce lieu où pour que la police les laisse tranquilles mieux vaut ne pas se faire remarquer. Yasmina Khadra est un romancier algérien de langue française. Salué dans le monde entier comme un écrivain majeur, il est l’auteur, entre autres, de Cousine K (prix de la Société des gens de lettres), La Part du mort (Prix du meilleur polar francophone), Les Hirondelles de Kaboul (Newsweek Award ; Prix des libraires algériens), L’Attentat (Prix des libraires 2006) et de Ce que le jour doit à la nuit, best-seller de l’année 2008. Son œuvre est traduite dans trente-huit pays.
Yasmina Khadra est un romancier algérien de langue française. Salué dans le monde entier comme un écrivain majeur, il est l’auteur, entre autres, de Cousine K (prix de la Société des gens de lettres), La Part du mort (Prix du meilleur polar francophone), Les Hirondelles de Kaboul (Newsweek Award ; Prix des libraires algériens), L’Attentat (Prix des libraires 2006) et de Ce que le jour doit à la nuit, best-seller de l’année 2008. Son œuvre est traduite dans trente-huit pays.  La Femme du caïd est le titre d’un ouvrage de Fatéma Bakhaï paru aux éditions Dar El-Gharb. Dans ce livre de 248 pages, l’auteur relate dans un style romanesque la situation de la femme algérienne au siècle dernier.
La Femme du caïd est le titre d’un ouvrage de Fatéma Bakhaï paru aux éditions Dar El-Gharb. Dans ce livre de 248 pages, l’auteur relate dans un style romanesque la situation de la femme algérienne au siècle dernier.















