 Vieil Alger (éditions Orizons, Paris 2009) est un recueil de cinq belles nouvelles que Pierre Fréha nous donne à lire. Elles constituent une sorte de parenthèses ouvertes sur la famille Cazès, déjà personnage central de son précédent roman, la Conquête de l’oued.
Vieil Alger (éditions Orizons, Paris 2009) est un recueil de cinq belles nouvelles que Pierre Fréha nous donne à lire. Elles constituent une sorte de parenthèses ouvertes sur la famille Cazès, déjà personnage central de son précédent roman, la Conquête de l’oued.
C’est en fait l’histoire de l’une des deux branches du judaïsme algérien, les Sépharades, chassés d’Andalousie, en même temps que les Arabo-berbères, par les Rois catholiques, au cours de la Reconquista, en 1492. L’autre branche de ce judaïsme en Algérie trouve son origine dans une partie de la diaspora (dispersion) des Juifs de Palestine, il y a 2 000 ans. L’histoire des Cazès s’emboîte ainsi dans celle, romancée, de l’Algérie, sous dominations ottomane puis française.
Arrivés à Alger, dans une conjoncture favorable, les frères Isaac et Jacob Cazès purent ouvrir un magasin d’horlogerie à Bab Azzoun, dans la Casbah d’Alger. Cette boutique, que plusieurs générations de Cazès héritèrent tour à tour, sert pour le narrateur de lucarne sur la chronique algéroise.
Elle a en effet assisté à l’arrivée en sauveur, vers 1515, des quatre frères Aroudj, avant qu’ils ne se transforment en oppresseurs. Ce fut le point de départ de trois siècles de présence ottomane dans la future Régence d’Alger.
Ces célèbres corsaires, qui écumaient la mer Méditerranée au même titre que les puissances chrétiennes européennes, et bien que dotés d’une armada, mirent quinze longues années avant de se décider à mettre fin au blocus du port d’Alger par la marine de guerre espagnole.
La boutique s’est trouvée également peu ou prou mêlée à quelques-uns de ces événements. Baba Aroudj, après avoir trucidé le roi d’Alger, Salem Toumi, y avait acheté une magnifique montre, un cadeau pour la sublime Zaphyra, la reine veuve, qu’il voulait s’offrir vainement en prime pour son crime.
C’est également entre ces murs que se fomenta une partie du complot des notables algérois et ceux de la Mitidja, voisine, pour se libérer du joug des Aroudj ; une tentative que ces derniers avaient baignée dans le sang.
Mais le pire que la population eut à subir, fut la prédilection sexuelle perverse des Janissaires ottomans pour leurs filles et leurs garçons qu’ils allaient jusqu’à kidnapper et séquestrer, des semaines ou des mois dans leurs casernes.
C’est ainsi que ce malheur frappa doublement Djamel, un proche des Cazès ; un Algérois de naissance, fils de Grimaldi, un immigré d’origine génoise, qui se maria avec une Algérienne, après sa conversion à l’islam.
Ces soldats ont non seulement enlevé son fils, Omar, mais ils l’ont lui-même enfermé dans un sac en toile de jute et jeté à la mer, parce qu’il avait osé leur réclamer la libération de son enfant.
Puis, vint en 1870 le décret Crémieux qui octroya d’office la nationalité française aux Juifs d’Algérie. Si cette décision avait emporté l’adhésion de la majorité d’entre eux, qui y ont vu une protection contre l’antisémitisme et l’oppression qu’ils subissaient de la part de la société coloniale, Simon, le père du narrateur, ainsi qu’une minorité de ses coreligionnaires, y ont vu plutôt un moyen de dépersonnalisation et une mesure discriminatoire envers leurs compatriotes musulmans.
Le narrateur rappelle que le système colonial avait refusé jusqu’au bout l’égalité des droits aux Algériens musulmans, qui constituaient la très grande partie des habitants, et de surcroît dans leur propre pays.
Cette opposition est également illustrée dans cette fiction par, d’un côté, le rabbin libéral métropolitain, Mahir Charleville, envoyé de Paris quelques années avant l’avènement de ce décret pour officier dans la synagogue d’Oran, en vue de faire « évoluer » les Juifs autochtones, et de l’autre, le rabbin berbère, Kanaouï, qui ne voyait pas pourquoi les judéo-berbères de son pays devraient abandonner leur algérianité, alors qu’ils la vivent en plein accord avec leur judaïté.
Mais le lobby colonial considérait ce décret comme un scandale et dont le seul tort était qu’il accordait aux Juifs les mêmes droits que les populations d’origine européenne, pourtant nouvellement installées en Algérie.
C’est ainsi qu’Edouard Drumont, de sinistre mémoire, et ses sbires fomentaient régulièrement des campagnes nauséabondes faisant des Juifs les boucs émissaires de tous les maux de la colonie algérienne et de la métropole, des émeutes contre eux et le pillage de leurs magasins, qu’ils appelaient aussi à boycotter, listes nominatives à l’appui, qu’ils publiaient dans leurs feuilles de choux, notamment la Libre parole, de Drumont, pratiquaient la discriminations à l’embauche des demandeurs d’emplois juifs…
Éléonore, qui avait tenu à ce que ses enfants portent des prénoms français, au grand dam de son mari, afin qu’ils ne soient plus la cible des racistes, subit de plein fouet ainsi que son époux, et surtout leurs enfants et petits-enfants, les néfastes conséquences de l’abrogation du décret Crémieux et la promulgation de lois scélérates antijuives, par le régime de la Collaboration du maréchal Pétain, durant la Seconde Guerre mondiale.
Joseph écrivit à son fils Philippe résidant à Vichy pour l’informer des campagnes antisémites, auxquelles ses « frères » musulmans ne voulaient pas s’associer, en dépit de l’habileté de la propagande coloniale pour monter les uns contre les autres, Juifs et musulmans.
Pour sa part, Max Régis, un jeune Juif, débarquant à peine de métropole, décrit la chaleur et la fraternité avec lesquelles Ben Brimath, chef du groupe des conseillers municipaux musulmans d’Alger, l’avait accueilli et s’était entretenu avec lui. « Le maire est un excité, un fanatique, lui confie–t-il. Il lance des appels à l’action directe antijuive, mais nous ne le suivrons jamais. »
Pierre Fréha, roman français d’origine algérienne, fait de nouveau preuve de son talent de conteur dans ce recueil de nouvelles, qui méritent d’être lues.
Source : Respublica










 Un village quelque part en Algérie. C’est un village, ordinaire qui ressemble à tous les autres villages du nord du pays.
Un village quelque part en Algérie. C’est un village, ordinaire qui ressemble à tous les autres villages du nord du pays.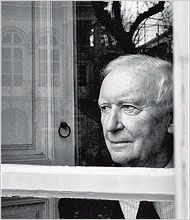 « Salaam la France », commence avec une visite d’investisseurs français dans l’Algérie indépendante. Frédéric fait partie de cette délégation qui vient ramasser de l’argent dans un pays où le pétrole et le gaz ont fait perdre la tête à de nombreux dirigeants. Frédéric a l’amour de cette terre qui lui valu son premier travail, médecin de bled, bien des années auparavant. C’est cette belle et splendide Numidie qui lui a appris la vie, l’amour, la solidarité, le sens de l’existence face à l’absurdité du monde. « Rien n’égale la servilité de l’homme d’affaires français coincé entre l’espoir du profit et la menace de représailles », écrit le lauréat du grand prix du roman de l’Académie française.
« Salaam la France », commence avec une visite d’investisseurs français dans l’Algérie indépendante. Frédéric fait partie de cette délégation qui vient ramasser de l’argent dans un pays où le pétrole et le gaz ont fait perdre la tête à de nombreux dirigeants. Frédéric a l’amour de cette terre qui lui valu son premier travail, médecin de bled, bien des années auparavant. C’est cette belle et splendide Numidie qui lui a appris la vie, l’amour, la solidarité, le sens de l’existence face à l’absurdité du monde. « Rien n’égale la servilité de l’homme d’affaires français coincé entre l’espoir du profit et la menace de représailles », écrit le lauréat du grand prix du roman de l’Académie française. 
 Dans son dernier roman Un parfum de vie, Adriana Lassel plonge dans l’histoire de l’Algérie du XVIIe et fin du XXe siècle.
Dans son dernier roman Un parfum de vie, Adriana Lassel plonge dans l’histoire de l’Algérie du XVIIe et fin du XXe siècle.

 Voir, céder, participer, laisser faire ou agir, que ce soit pour empêcher ou pour commettre… elles sont nombreuses et complexes les interrogations intimes qui pétrissent les personnages de Jérôme Ferrari. Ce n’est pourtant pas un livre cérébral ou psychologisant qu’il donne à lire, mais une réflexion dense et lyrique sur la mémoire, la culpabilité, la compassion, le devoir et l’honneur, à travers l’histoire du capitaine André Degorce, responsable du service de renseignements de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Maintenant son attention à des thèmes déjà étreints dans ses précédents romans (notamment dans Un dieu un animal, en 2009, où il était déjà question de guerres et de l’incapacité à revenir au monde après avoir plongé dans les ténèbres), l’écrivain publie l’un des meilleurs livres de cette rentrée.
Voir, céder, participer, laisser faire ou agir, que ce soit pour empêcher ou pour commettre… elles sont nombreuses et complexes les interrogations intimes qui pétrissent les personnages de Jérôme Ferrari. Ce n’est pourtant pas un livre cérébral ou psychologisant qu’il donne à lire, mais une réflexion dense et lyrique sur la mémoire, la culpabilité, la compassion, le devoir et l’honneur, à travers l’histoire du capitaine André Degorce, responsable du service de renseignements de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Maintenant son attention à des thèmes déjà étreints dans ses précédents romans (notamment dans Un dieu un animal, en 2009, où il était déjà question de guerres et de l’incapacité à revenir au monde après avoir plongé dans les ténèbres), l’écrivain publie l’un des meilleurs livres de cette rentrée.













